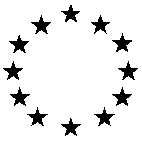ETABLISSEMENT DE
LA FILIATION BIOLOGIQUE
L'expertise biologique est de droit en matière de filiation,
sauf s'il existe un motif légitime de ne pas y procéde .
L'arrêt frappé de pourvoi avait jugé que la demande tendant
à voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été
recueilli au préalable des indices ou présomptions de paternité.
L'Assemblée plénière de la Cour de Cassation juge que
l'expertise biologique état de droit en matière de filiation, sauf s'il existe
un motif légitime de ne pas y procéder, la cour d'appel a violé les
articles 340 et 311-12 du code civil, dans leur rédaction applicable à
l'espèce.
05-17.975, 06-10.039
Arrêt n° 562 du 23 novembre 2007
Cour de cassation - Assemblée plénière
NOTA F& C :
"En finir avec les adminicules…"
Le
"respect" de la "vie familiale" exige que "la réalité
biologique et sociale prévale sur une présomption légale heurtant de front tant
les faits établis que les vœux des personnes concernées, sans réellement
profiter à personne"(CEDH)
par Bertrand FAVREAU
Ainsi que le suggérait M. Régis de Gouttes,
premier avocat général dans son avis : "à la date où il a été rendu
[9 avril 2004], la motivation de l'arrêt était conforme à l'article 340 du code
civil alors applicable, qui disposait :"La
paternité hors mariage peut être judiciairement déclarée. La preuve ne peut en
être rapportée que s'il existe des présomptions ou indices graves". Et
il rappelait que , dès avant la réforme de l'ordonnance du 4 juillet 2005, la
Cour de cassation, dans des arrêts de la première chambre civile des 28 mars
2000 et 12 mai 2004 , a décidé, au visa des articles 340 et 311-12
du code civil, que "l'expertise
biologique est de droit en matière de filiation, sauf s'il existe un motif
légitime de ne pas y procéder".
Un arrêt ultérieur de la première chambre civile du 14 juin
2005 devait confirmer cette position en jugeant
qu'encourt la cassation l'arrêt qui énonce que c'est à tort que les premiers
juges ont ordonné, dans une action en recherche de paternité, un examen comparé
des sangs, aucun indice grave ou présomption n'étant rapporté en l'espèce,
alors que l'expertise biologique est de droit en matière de filiation sauf s'il
existe un motif légitime de ne pas y procéder.
C'est donc cette
interprétation qui a été consacrée par le nouvel article 327 du code civil issu
de l'ordonnance n° 2005-759 du 4 juillet 2005 portant réforme de la filiation :
"La paternité hors mariage peut être
judiciairement déclarée. L'action en recherche de paternité est réservée à
l'enfant".
Et comme le souligne M.
Régis de Gouttes : "Dans ce nouveau texte, l'exigence
d'adminicules préalables disparaît clairement." Au regard de l'état
actuel du droit, la motivation de
l'arrêt attaqué était donc inappropriée
ce que la cour d'appel a énoncé à tort que "la demande tendant à
voir ordonner une expertise biologique n'est recevable que s'il a été recueilli
au préalable les indices ou présomptions de paternité", alors qu'une telle
demande ne peut désormais être refusée que s'il existe un motif légitime de ne
pas ordonner d'expertise. Dont acte.
Il est regrettable que le pourvoi ne se soit pas placé sous
l'angle de l’article 8 de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme, ainsi libellé :« 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance ", ce qui en cas de
dénouement malheureux devant la Cour régulatrice aurait facilité la
recevabilité ultérieure de la Cour européenne; La Cour de Strasbourg
a dit à maintes reprises que les procédures ayant trait à la paternité
tombent sous l’empire de l’article 8 (Mikulić
c. Croatie, arrêt du 7 février 2002
no 53176/99, CEDH 2002-I § 51 ou Mizzi c. Malte,
arrêt du 12 janvier 2006, n° 26111/02, CEDH 2006, § 104).
Le droit de connaître son ascendance se trouve bien dans le
champ d’application de la notion de « vie privée », qui englobe des
aspects importants de l’identité personnelle dont l’identité des géniteurs fait
partie (Odièvre c. France [GC], arrêt
du 13/02/2003, no 42326/98,
§ 29, CEDH 2003-III, et Mikulić, précité,
§ 53). La Cour a également dit dans les
affaires Mikulić et Jäggi qu'il n'y a
"aucune raison de principe de considérer la notion de « vie
privée » comme excluant l’établissement d’un lien juridique ou biologique
entre un enfant né hors mariage et son géniteur". (Mikulić,
précité ; Jäggi c. Suisse, n° 58757/00, CEDH 2006, §
25). Par conséquent, les faits de la cause tombaient sous l’empire de l’article
8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.
Si l’article 8 a essentiellement pour objet de prémunir
l’individu contre les ingérences arbitraires des pouvoirs publics, on sait que
des obligations positives inhérentes à un respect effectif de la vie privée ou
familiale s’ajoutent à cet engagement négatif . Elles
peuvent impliquer l’adoption de mesures visant au respect de la vie privée
jusque dans les relations des individus entre eux (voir Mikulić
c. Croatie, précité, § 57 ; Mizzi c. Malte,
précité, § 105.)
Ce qui concerne l'action en reconnaissance de paternité est
transposable à toute action en contestation de paternité dès lors qu'elle
reposerait sur une volonté d'établir une filiation biologique véritable.
En termes de droits fondamentaux, le droit de contester une
paternité juridique lorsque celle-ci ne correspond pas à la réalité biologique
est incontestable. Ainsi la Cour a-t-elle pu condamner la Russie pour la
brièveté du délai de prescription de l'action qui entravait le droit
fondamental d'un requérant (Chofman c. Russie, arrêt du 24 novembre 2005), ou plus encore condamner le fait pour un
homme marié de ne pas pouvoir contester sa paternité alors même qu'un test ADN
démontre qu'il n'est pas le père de l'enfant (Mizzi c. Malte , précité).
Conformément à sa jurisprudence constante, la Cour de
Strasbourg rappelle qu'elle n'a point
pour tâche de se substituer aux autorités nationales compétentes pour trancher
les litiges au niveau national mais d’examiner sous l’angle de la Convention
Européenne des Droits de l'Homme les décisions que ces autorités ont rendues
dans l’exercice de leur pouvoir discrétionnaire (arrêts Mikulić,
précité, § 59, Hokkanen c. Finlande,
23 septembre 1994, série A no 299-A, p. 20, § 55 ).
En matière de paternité, lorsqu'elle est saisie, elle
s'efforce d'apprécier si l’Etat
défendeur, en traitant l’action en contestation de paternité du requérant, a
agi en méconnaissance de son obligation positive découlant de l’article 8 de la
Convention Européenne des Droits de l'Homme. (Mizzi c. Malte, précité, § 107). Dès lors, force est d'admettre
qu'un requérant est fondé à se plaindre
de toute entrave à son action et ce que l'avocat général Régis de Gouttes
appelle, avec un bonheur d'expression dont il a le secret, des " adminicules préalables " ne
constitue pas le seul obstacle. Il existait d'autres entraves dans les articles
du code civil, dans la version en vigueur avant 2006, l’ont empêché de
former une demande ayant des chances d’être accueillie par les juridictions
nationales.
- Le délai de
prescription pour engager la
procédure en contestation de paternité qui a empêche l’intéressé d’exercer
une action en désaveu de paternité, faute pour lui d’avoir pris conscience
dans l’année suivant la naissance de l’enfant qu’il pouvait ne pas être le
père de celui-ci, n’était pas proportionnée aux buts légitimes poursuivis.
(Chofman c. Russie, 24 novembre 2005 n°
74826/01.)
Tel est le cas de l'affaire Paulik où était en cause
l'impossibilité pour un père de contester une paternité juridiquement établie
en présence d'une analyse ADN, prouvant qu’il n’était pas le père de la
personne en question parce que l'état de la législation du pays n'offrait pas
de procédure permettant de rendre la
situation juridique conforme à la réalité biologique. Dans un tel cas la CEDH
avait déjà conclu "que l’ordre juridique interne a manqué à garantir le
respect de la vie privée".
Au-delà des présomptions légales, il convient que les
législations internes tirent effectivement toutes les
conséquences de l'expertise biologique .
En effet, la Cour a déjà dit qu'une situation dans laquelle
une présomption légale peut prévaloir sur la réalité biologique ne saurait être
compatible avec l’obligation de garantir le « respect » effectif de
la vie privée et familiale, même eu égard à la marge d’appréciation dont
jouissent les Etats.
Aux yeux de la Cour, le "respect" de la "vie
familiale" exige que "la réalité biologique et sociale prévale sur
une présomption légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux
des personnes concernées, sans réellement profiter à personne", et cela même eu égard à la marge d’appréciation
dont jouissent les Etats. (arrêt Kroon et autres, précité, § 40).
La Cour a aussi constaté que cela ne pouvait aboutir a
empêcher la consécration du principe de la reconnaissance de la réalité
biologique que au regard des articles 8 et 14 de la Convention (par exemple arrêt du 27 octobre 1994, Kroon et autres c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994,
série A n° 297-C,) et cela même à
propos de l'établissement de filiation réelle d'un enfant mort-né ( Znamenskaya c. Russie
n° 77785/01, arrêt du 2 juin 2005, § 31
)
De même, dans son arrêt du 18 mai 2006 (Rozanski c. Pologne), la Cour a
considéré que le fait pour un père biologique d'avoir été empêché d'établir sa
paternité constitue une violation du droit
au respect de la vie familiale au
sens de l’article 8.
Il est plus important encore de souligner que la Cour en a
souligné le motif : les autorités avaient simplement répété dans leurs
décisions que le simple fait que l’enfant avait été légalement reconnu par un
autre homme suffisait pour justifier le rejet des demandes du requérant tendant
à la reconnaissance de sa paternité biologique.
(Rózanski c. Pologne, arrêt du 18 mai 2006, n°
55339/00, § 77.
Ce qui est valable pour le père est valable pour l'enfant,
car il s'agit d'une seule et même vérité. Ainsi que la rappelé la Cour , l'expression « toute personne » de
l'article 8 de la Convention s'applique à l'enfant comme à la mère.
D'un côté, il y a le droit à la connaissance de ses origines
qui trouve son fondement dans l'interprétation extensive du champ d'application
de la notion de vie privée. L'intérêt vital de l'enfant dans son épanouissement
est également largement reconnu dans l'économie générale de la Convention
(voir, parmi beaucoup d'autres, les arrêts Johansen
c. Norvège, 7 août 1996, Recueil 1996-III, p. 1008, § 78, Mikulić précité, § 64, ou Odièvre c. France [GC], arrêt du 13 février 2003 n°
42326/98,CEDH 2003-III § 44. ). D'un
autre côté, il existe sur un plan plus général
le respect de la vie familiale qui
"exige que la réalité biologique et sociale prévale sur une présomption
légale heurtant de front tant les faits établis que les vœux des personnes
concernées, sans réellement profiter à personne", et cela " même eu
égard à la marge d’appréciation dont ils jouissent" . (Kroon et autres c. Pays-Bas, arrêt du 27 octobre 1994, série A n° 297-C,
§§ 31, 40 ).
Dès lors, il appartient au système
juridique de l'Etat concerné de prévoir des mesures effectives permettant
d'obvier au défaut de consentement de l'intéressé.
Dans l'affaire Mikulic, la Cour a
considéré qu'"un système qui ne
prévoit aucun moyen d’obliger le père allégué de se conformer à une ordonnance
de justice lui intimant de se soumettre à des tests ADN, peut en principe être
considéré comme compatible avec l’article 8, même en tenant compte de la marge de l'appréciation dont ils
jouissent". (Mikulić, précité, §
7.2.2002 § 64). Mais , dans l'affaire Mikulić, où elle a constaté
une violation de l'article 8, la Cour
avait relevé que le droit interne ne prévoyait aucune mesure permettant de
contraindre le père à se conformer aux ordonnances du tribunal lui intimant de
se soumettre à des tests ADN. Il ne comportait en outre aucune disposition
régissant les conséquences du refus de l’intéressé.
Si la Cour a
toujours mis en exergue la "nécessité de protéger les tiers", cette
réserve n'a pas à intervenir en l'espèce. En effet, dans l'affaire Mikulić,
comme en l'espèce, le tribunal
de première instance avait omis, pour résoudre la question de paternité en
l’espèce, d’apprécier d’autres éléments pertinents. (Mikulić,
précité, § 61).
Dans l’affaire Jäggi c. Suisse, la Cour a considéré
que les personnes essayant d’établir leur ascendance ont "un intérêt vital, protégé par la Convention Européenne des Droits
de l'Homme, à obtenir les informations qui leur sont indispensables pour
découvrir la vérité sur un aspect important de leur identité personnelle".
Pour examiner si la nécessité de protéger les tiers peut
exclure la possibilité de contraindre ceux-ci à se soumettre à quelque analyse
médicale que ce soit, notamment à des tests ADN, la Cour a donc mis en balance les intérêts en présence, à savoir le
droit du requérant à connaître son ascendance et le droit des tiers à
l’intangibilité du corps du défunt, le droit au respect des morts ainsi que
l’intérêt public à la protection de la sécurité juridique.
Elle a estimé que l’intérêt que peut avoir un individu à
connaître son ascendance ne cesse nullement avec l’âge, bien au contraire et
que pour s’opposer au prélèvement ADN, qualifié par la Cour de "
mesure relativement peu intrusive", la famille n’avait invoqué
aucun motif d’ordre religieux ou philosophique.
Enfin , à propos du prélèvement de l’ADN d'un défunt dont doit être
prélevé qui pas définition ne saurait y consentir, la Cour a également posé le
principe selon lequel " la
protection de la sécurité juridique ne saurait à elle seule suffire comme
argument pour priver le requérant du droit de connaître son ascendance".
En vertu de la jurisprudence de la Cour, une situation
faisant prévaloir une présomption légale sur une réalité biologique et sociale,
sans tenir compte de celle-ci et des souhaits des personnes concernées et sans
que la décision ait réellement profité à quiconque, n’était pas compatible, eu
égard même à la marge d’appréciation dont l’Etat défendeur jouissait en la
matière, avec l’obligation de garantir à la requérante un « respect »
effectif de sa vie privée et familiale.
En l'occurrence il s'agit d'une motivation que la Cour a
déjà été amenée à déclarer non pertinente dès lors que les " autorités ont
simplement répété dans leurs décisions que le simple fait que l’enfant avait
été légalement reconnu par un autre homme suffisait pour justifier le rejet des
demandes du requérant tendant à la reconnaissance de sa paternité
biologique". (Rózanski c. Pologne, arrêt du 18 mai 2006, n°
55339/00, § 77). D'une façon plus
générale, la Cour a constaté dans
l'affaire Mikulic c. Croatie, que la procédure
existante n'a pas ménagé " un juste équilibre entre le droit de la
requérante de voir dissiper sans retard inutile son incertitude quant à son
identité personnelle et le droit de son père présumé de ne pas subir de tests ADN " et que "
l'inefficacité des tribunaux a maintenu la requérante dans un état
d'incertitude prolongée quant à son identité personnelle". (Mikulic c. Croatie, précité, §§ 65-66).
Il n'est pas certain à ce jour que la législation française
et la pratique des juridictions ait totalement achevé son aggiornamento pour permettre sans entrave l'établissement de la
filiation biologique, ce qui n'est qu'une élémentaire manifestation ou
reconnaissance de la vérité consubstantielle à la justice.
Bertrand FAVREAU
Avocat à la Cour
DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE - INTERDICTION DE LA DISCRIMINATION
S’agissant
d’une allégation de discrimination en raison de l’homosexualité de la
requérante, la Cour rappelle que si l’article 14 n’a pas d’existence
indépendante, son application ne présuppose pas nécessairement la violation de
l’article 8 : il suffit que les faits de la cause tombent « sous
l’empire » de ce dernier. Tel est le cas dans la présente
affaire, dès lors que la législation française accorde expressément aux
personnes célibataires le droit de demander l’agrément en vue d’adopter et qu’elle
établit une procédure à cette fin
GRAND
CHAMBRE
E.B.
c. FRANCE
22.1.2008
Violation de l’article 14 combiné avec
l’article 8
La requête porte sur le refus des autorités
françaises de faire droit à la demande d’agrément pour adopter de la requérante
en raison, selon elle, de son orientation sexuelle.
La requérante déposa auprès des services
sociaux du département du Jura une demande d’agrément pour adopter un enfant.
Durant la procédure d’adoption, elle fit part de son homosexualité et de sa
relation stable avec R.
Sur le fondement des rapports rendus par
une assistante sociale et une psychologue, la Commission chargée d’examiner les
demandes d’agrément rendit un avis défavorable. Peu après, le président du
conseil général du Jura prit une décision de refus de la demande d’agrément.
Suite à un recours de la requérante, le président du conseil général confirma
son refus. Ses deux décisions furent motivées par le défaut de « repères
identificatoires » dû à l’absence d’image ou de référent paternel et par l’ambiguïté
de la situation de la compagne de la requérante par rapport à la procédure
d’adoption.
Saisi par la requérante, le tribunal
administratif de Besançon annula les deux décisions du président du conseil
général. Le département du Jura interjeta appel de ce jugement. La cour
administrative d’appel de Nancy annula le jugement du tribunal administratif;
elle estima que le refus d’agrément n’était pas fondé sur le choix de vie de la
requérante et n’avait donc pas entraîné de violation des articles 8 et 14 de la
Convention.
La requérante forma un pourvoi en
cassation, faisant notamment valoir que sa demande d’adoption avait été rejetée
en raison de ses orientations sexuelles. Le Conseil d’Etat rejeta le pourvoi
d’E.B., au motif notamment que la cour administrative d’appel n’avait pas fondé
sa décision sur une position de principe concernant
les orientations sexuelles de l’intéressée, mais avait tenu compte des besoins
et de l’intérêt d’un enfant adopté.
Invoquant l’article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 8, la requérante alléguait avoir subi, à
toutes les phases de la procédure de demande d’agrément en vue d’adopter, un
traitement discriminatoire fondé sur son orientation sexuelle et portant
atteinte à son droit au respect de sa vie privée.
Décision de la
Cour
La Cour rappelle tout d’abord que si le
droit français et l’article 8 ne
garantissent pas le droit d’adopter ou de fonder une famille, ce dont les
parties conviennent, la notion de « vie privée », au sens de
l’article 8, est quant à elle un concept large qui comprend un certain nombre
de droits. S’agissant en l’espèce d’une allégation de discrimination en raison
de l’homosexualité de la requérante, la Cour rappelle également que si
l’article 14 n’a pas d’existence indépendante, son application ne présuppose
pas nécessairement la violation de l’article 8 : il suffit que les faits de la
cause tombent « sous l’empire » de ce dernier. Tel est le
cas dans la présente affaire, dès lors que la législation française
accorde expressément aux personnes célibataires le droit de demander l’agrément
en vue d’adopter et qu’elle établit une procédure à cette fin.
En conséquence, la Cour estime que l’Etat,
qui est allé au-delà de ses obligations découlant de l’article 8 en créant
pareil droit, ne peut ensuite prendre des mesures discriminatoires dans sa mise
en application. Or la requérante se plaint d’une discrimination dans l’exercice
de son droit accordé par la législation interne en raison de son orientation
sexuelle, notion couverte par l’article 14.
L’article 14 de la Convention, combiné avec
l’article 8, s’applique donc en l’espèce.
Article 14 de la
Convention, combiné avec l’article 8
Après avoir opéré un parallèle avec une
précédente affaire, la Cour relève que les autorités
administratives internes, puis les juridictions saisies du recours de la
requérante, se sont principalement fondées sur deux motifs pour rejeter la
demande d’agrément en vue d’adopter : l’absence de référent paternel dans
le foyer de la requérante, ainsi que le comportement de la compagne déclarée de
celle-ci.
La Cour considère que l’attitude de la
compagne de la requérante n’est pas sans intérêt et sans pertinence pour
l’appréciation de la demande d’agrément. A ses yeux, il est légitime que les
autorités s’entourent de toutes les garanties en vue de l’accueil éventuel d’un
enfant dans une famille, notamment si elles constatent la présence non pas d’un
mais de deux adultes dans le foyer d’accueil. Pour la Cour, un tel motif est
étranger à toute considération sur l’orientation sexuelle de l’intéressée.
S’agissant du motif tiré de l’absence de
référent paternel, la Cour estime que cela ne pose pas nécessairement problème
en soi, mais qu’il est permis de s’interroger sur son bien-fondé en l’espèce,
la demande d’agrément étant présentée par un célibataire et non par un couple.
Aux yeux de la Cour, un tel motif aurait donc pu conduire à un refus arbitraire
et servir de prétexte pour écarter la demande de la requérante en raison de son
homosexualité, et le Gouvernement n’a pas été en mesure de prouver que son
utilisation au plan interne ne conduisait pas à des discriminations. La Cour ne
conteste pas l’intérêt d’un recours systématique à l’absence de référent
paternel, mais bien l’importance que lui accordent les autorités internes
s’agissant d’une adoption par une personne célibataire.
Le fait que l’homosexualité de la
requérante ait été aussi présente dans les motivations des autorités internes
est significatif, bien que les juridictions aient jugé qu’elle ne fondait pas
la décision litigeuse. Outre leurs considérations sur les « conditions de
vie » de la requérante, les juges internes ont surtout confirmé la
décision du président du Conseil général, proposant
et justifiant pour l’essentiel de rejeter la demande pour les deux motifs
litigieux : la rédaction de certains avis révélait une prise en compte
déterminante de l’homosexualité de la requérante ou, parfois, de son statut de
célibataire pour le contester et lui opposer alors même que la loi prévoit
expressément le droit pour les célibataires de demander l’agrément.
Pour la Cour, la référence à
l’homosexualité de la requérante était sinon explicite du moins implicite et
l’influence de son homosexualité sur l’appréciation de sa demande est non
seulement avérée, mais a également revêtu un caractère décisif.
Partant, elle considère que la requérante a
fait l’objet d’une différence de traitement. Si cette dernière se rapporte
uniquement à l’orientation sexuelle, elle constitue une discrimination au
regard de la Convention. En tout état de cause, il faut des raisons
particulièrement graves et convaincantes pour la justifier s’agissant de droits
tombant sous l’empire de l’article 8. Or de telles raisons n’existent pas en
l’espèce, puisque le droit français autorise l’adoption d’un enfant par un célibataire,
ouvrant ainsi la voie à l’adoption par une personne célibataire
homosexuelle. De plus, le code civil reste muet quant à la nécessité d’un
référent de l’autre sexe et, par ailleurs, la requérante présentait, pour
reprendre les termes de l’arrêt du Conseil d’Etat, « des qualités humaines
et éducatives certaines ».
La Cour ayant constaté que la situation de
la requérante a fait l’objet d’une appréciation globale par les autorités
internes, lesquelles ne se sont pas fondées sur un motif à titre exclusif, mais
sur « l’ensemble » des éléments, les deux principaux motifs utilisés
doivent être appréciés cumulativement : ainsi, le caractère illégitime
d’un seul (absence de référent paternel) a pour effet de contaminer l’ensemble
de la décision.
La Cour conclut, par dix voix contre sept, à la violation de l’article 14 combiné avec
l’article 8 de la Convention.
En application de l’article 41 de la
Convention, la Cour, par onze voix contre six, alloue à la requérante
10 000 Euros pour dommage moral, ainsi que 14 528 EUR
pour frais et dépens.
E.B. c.
France (requête
no 43546/02). Les
juges Lorenzen et Jebens
ont exprimé une opinion concordante, et les juges Costa, Türmen,
Ugrekhelidze, Jočienė,
ainsi que les juges Zupančič, Loucaides et Mularoni des opinions
dissidentes
Jurisprudence de Strasbourg Evans c.
Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, § 75 et §§ 77-81, CEDH 2007 ; Hokkanen
c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A n° 299-A, p. 20, § 55 ; Keegan c. Irlande, arrêt du 26 mai 1994, série A n° 290, p.
19, § 49 ; Mikulic c. Croatie, n° 53176/99, § 59,
CEDH 2002-I ; P., C. et S. c. Royaume-Uni, n° 56547/00, § 122, CEDH 2002-VI ;
Reinhardt et Slimane-Kaïd c. France (judgment of 31 mars 1998, Recueil des arrêts et décisions
1998-II, p. 666, §§ 106-107 ; Riha c. France (déc.),
n° 71443/01, 24 juin 2004 ; V.S. c. Allemagne (déc.), n° 4261/02, 22 mai 2007
Sources Externes Convention des Nations Unies relative aux droits
de l'enfant ; Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et la
coopération en matière d'adoption international ; Convention européenne en
matière d'adoption des enfants
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
KEARNS c. FRANCE
10/01/2008
Non-violation de l'art. 8
La
requête concerne la demande de restitution d’un enfant suite à un
accouchement anonyme, et ce au-delà des délais prévus par la loi pour
accueillir une telle demande.
Mariée et résidant en Irlande, la
requérante accoucha le 18 février 2002, en France, d’une petite fille née d’une
relation extraconjugale.
Demandant le secret de cette naissance, la
requérante signa un procès-verbal d’admission de l’enfant comme pupille de
l’Etat et donna son consentement à son adoption le 19 février 2002. Les
conditions et les conséquences d’un accouchement anonyme lui furent exposées
durant deux entretiens avec les services sociaux, notamment quant au délai de
deux mois suivant l’acte de remise de l’enfant par la mère pour en demander la
restitution. Durant ces entretiens, la requérante fut assistée d’une infirmière
et d’un médecin parlant anglais et qui firent fonction d’interprètes.
Le 7 mai 2002, l’enfant fut placé, par les
services de l’Etat, dans une famille d’accueil en vue de son adoption plénière.
Les 25 et 26 juillet 2002, la requérante se
présenta auprès de la maternité de l’hôpital, puis des services sociaux
français en demandant la restitution de l’enfant. Sa demande se heurtant à un
refus en raison de l’expiration du délai de rétractation de deux mois, la
requérante saisit le tribunal de grande instance de Lille. Elle faisait valoir
que son consentement, tel qu’exprimé le 19 février 2002, avait été vicié en
raison des pressions familiales auxquelles elle avait été soumise et qu’elle
n’avait pas eu une parfaite conscience des implications d’un accouchement
anonyme.
Le
tribunal rejeta les demandes de la requérante. La cour d’appel de Douai,
considérant que la requérante « de nationalité irlandaise, de langue
anglaise et ne parlant pas le français » n’avait pas été mise en mesure de
connaître « les conséquences en droit français d’un accouchement sous
X », infirma le jugement. Le 6 avril 2004, la Cour de cassation cassa et
annula l’arrêt de la cour d’appel.
L’adoption plénière de l’enfant par la
famille d’accueil fut prononcée le 17 juin 2004.
Le père biologique de l’enfant a saisi les
juridictions irlandaises en vue de voir reconnaître ses droits sur l’enfant.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la
requérante dénonce la brièveté du délai de deux mois qui lui a été laissé pour
réclamer son enfant. Elle se plaint également de ce que les autorités
françaises n’ont pas pris toutes les dispositions pour qu’elle comprenne
exactement la portée de ses actes, soulignant qu’elle n’a pas bénéficié d’une
aide linguistique suffisante pour lui permettre de comprendre toutes les
modalités et les délais.
Décision de la Cour
Article 8
Sur la durée du délai de rétractation
La Cour observe qu’il n’existe pas de
consensus international en matière d’adoption, et relève que, s’agissant du
délai de rétractation, il existe une diversité législative considérable parmi
les Etats membres du Conseil de l’Europe ayant établi un tel délai, la
rétractation du consentement étant permise dans certains systèmes juridiques
jusqu’au jugement d’adoption, alors que dans d’autres, à l’inverse, le
consentement est irrévocable. Pour les Etats qui ont prévu un délai fixe de
rétractation, celui-ci varie de dix jours à trois mois. Dès lors que la
question soulevée en l’espèce se rapporte à un domaine sur lequel il n’y a pas
de convergence entre les législations et les pratiques des Etats membres, la
Cour rappelle que la latitude dont bénéficie l’Etat est plus ample pour ménager
un équilibre entre les intérêts publics et privés concurrents une fois qu’il
s’est saisi de la question. Dans la mise en balance d’intérêts difficilement
conciliables, ceux de la mère biologique, ceux de l’enfant, ceux de la famille
d’accueil, ainsi que l’intérêt général, la Cour estime que c’est l’intérêt
supérieur de l’enfant qui doit primer.
Elle souscrit à cet égard aux arguments
avancés par le Gouvernement, résultant des travaux menés par les professionnels
de l’enfance, qui ont souligné que l’intérêt de l’enfant était de bénéficier le
plus rapidement possible de relations affectives stables dans sa nouvelle
famille. Elle relève également que le tribunal de grande instance a retenu que
la sérénité et la sécurité psychologique comme juridique de l’enfant devaient
être recherchées.
La Cour estime qu’en l’espèce, si le délai
de deux mois peut sembler bref, il paraît néanmoins suffisant pour que la mère
biologique ait le temps de réfléchir et de remettre en cause le choix
d’abandonner l’enfant. Tout en reconnaissant la détresse psychologique que Mme
Kearns a dû éprouver, la Cour observe que cette dernière était alors âgée de 36
ans, qu’elle était accompagnée par sa mère et qu’elle a été longuement reçue à
deux reprises après l’accouchement par les services sociaux.
Dans ces conditions, la Cour estime que le
délai prévu par la législation française vise à atteindre un équilibre et une
proportionnalité suffisants entre les intérêts en cause.
Par ailleurs, la Cour souligne que l’action
intentée par le père de l’enfant auprès des autorités irlandaises n’a pas
d’incidence sur la conclusion à laquelle elle parvient.
Sur l’information donnée à la requérante
La Cour relève que la requérante, de
nationalité irlandaise et résidant à Dublin, a fait le choix de venir accoucher
en France pour bénéficier de la possibilité, inconnue en droit irlandais, d’un
accouchement anonyme. A cet égard, elle note que la requérante s’est présentée
à la maternité, la semaine précédant l’accouchement, assistée notamment d’un
avocat. Par ailleurs, les deux longs entretiens avec les services sociaux ont
eu lieu en présence de personnes faisant fonction d’interprètes.
La Cour considère, au vu du formulaire de
consentement à l’adoption signé par la requérante et des différents documents
qui lui firent remis, qu’aucune ambiguïté ne pouvait subsister dans son esprit
sur les délais et conditions de restitution de sa fille.
La Cour estime que les autorités françaises
ont fourni à Mme Kearns une information suffisante et détaillée, en la faisant
bénéficier d’une assistance linguistique non prévue par les textes et en
s’assurant qu’elle soit informée aussi complètement que possible des
conséquences de son choix. En conséquence, toutes les dispositions pour qu’elle
comprenne exactement la portée de ses actes ayant été prises, il n’y a pas eu
violation de l’article 8.
Kearns
c. France (requête no
35991/04). Numéro 35991/04 Droit en
Cause Articles L.224-4 à 6 du code de l'action sociale et des familles ;
Articles 347 et 348-3 du code civil
Jurisprudence
Evans c. Royaume-Uni [GC], n° 6339/05, § 75 et §§ 77-81, CEDH 2007 ; Hokkanen c. Finlande, arrêt du 23 septembre 1994, série A
n° 299-A, p. 20, § 55 ; Keegan c. Irlande, arrêt du
26 mai 1994, série A n° 290, p. 19, § 49 ; Mikulic c.
Croatie, n° 53176/99, § 59, CEDH 2002-I ; P., C. et S. c. Royaume-Uni, n°
56547/00, § 122, CEDH 2002-VI ; Reinhardt et Slimane-Kaïd
c. France (judgment of 31 mars 1998, Recueil des
arrêts et décisions 1998-II, p. 666, §§ 106-107 ; Riha
c. France (déc.), n° 71443/01, 24 juin 2004 ; V.S. c. Allemagne (déc.), n°
4261/02, 22 mai 2007
Sources Externes Convention des Nations Unies relative aux
droits de l'enfant ; Convention du 29 mai 1993 sur la protection des enfants et
la coopération en matière d'adoption international ; Convention européenne en
matière d'adoption des enfants
Liste des arrêts de la Cour
ARRÊTS
DU JOUR
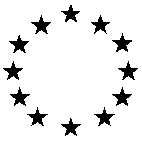
Vous pouvez trouver les décisions de la Cour européenne des Droits de l'Homme
sur le site de la Cour :
Cliquez sur ce lien
pour chercher un arrêt de la Cour de Strasbourg
F & C
|